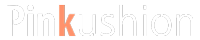En faisant abstraction de certains points embarrassants du livret, ce nouveau Weezer renoue avec la fulgurance power pop des débuts.
Pourvu que ses fans l’entendent, Rivers Cuomo s’excuse pour tout. Un mea culpa confessé d’emblée dès le premier couplet du single « Back The Shack » : « Désolé les gars, je ne réalisais pas que j’avais tellement besoin de vous. Je pensais que j’aurais une nouvelle audience. J’oubliais que la disco craint. Tout ce que j’ai récolté c’est personne. Et j’ai commencé à me sentir bête. Peut-être que je devrais jouer de la guitare lead et Pat devrait jouer de la batterie… » Ce neuvième album est donc présenté comme celui de la rédemption, avec en guise de caution « qualité », le retour de Rick Ocasek, l’historique producteur aux manettes derrière les albums Blue et Green. La nouvelle est non négligeable pour les fans qui ont assisté ces dix dernières années à la lente et inexorable perte de vitesse de cette formation américaine phare des années 90. Nombreux se sont détournés après quelques disques de moins en moins inspirés et puant l’orientation mainstream (des beats hip hop ridicules pour faire moderne sur le Red album, un duo avec une Spice Girls, quelques ballades sirupeuses). La déchéance du groupe ne faisait franchement pas plaisir à entendre.
Alors, est-ce que tout sera pardonné avec Everything will be alright in the end ? En tous les cas, les californiens soignent la présentation : distorsion servie bien baveuse comme au bon vieux temps, section rythmique au laser, et des refrains mordants qui laissent indubitablement quelques jolis traces. Un sérieux effort a été fait pour retirer des tics de production « dans le coup » et revenir à de bases saines. Sur le plan de la composition, il faut aussi reconnaitre que Weezer aligne sa plus solide collection de chansons depuis le Green album, voire Pinkerton pour les irréductibles.
Tout n’est pas parfait, loin de là. Mais pour l’essentiel, retrouver Rivers Cuomo reprendre ainsi du poil de la bête fait indubitablement plaisir à entendre, et d’enfoncer le clou en alignant quelques progressions d’accords buldozzers etmélodies touchantes dont lui seul à le secret – notamment les instantatanés « Cleopatra », « Foolish Father », « The British are Coming ». On pense même à la période bleue sur « Lonely Girl », où Cuomo nous rappelle qu’il est toujours aussi doué pour torcher une popsong ingénue à la « The Ramones meets the Beach Boys ». Parolier assez habile lorsqu’il s’agit de partager ses névroses, le leader à lunettes de Weezer rêgle ses comptes ici avec son père dans » Foolish Father », mais le disque dans l’ensemble est plutôt lumineux. On se passera toutefois du finale prétendument ambitieux « The Futuroscope Trilogy », qui comme son nom l’indique est divisé en trois parties, une sorte de Bohemian Rapsody indie rock boursouflé et indigeste (une sale manie certainement encouragée par Rick Ocasek, dont les premiers albums des Cars ont été produits par Roy Thomas Baker, illustre producteur de Queen).
Toutefois, si ce retour aux affaires est encourageant, il faudra néanmoins passer outre un détail : plus de la moitié des compositions sont co-signés par des collaborateurs extérieurs : le pompon revenant au très moyen « I’ve ha dit up here », écrit avec Justin Hawkins, chanteur castra des hard rockers The Darkness, et « Da Vinci », torché en collaboration avec un gars qui a composé des tubes pour les fausses lesbiennes russes T. A. T.U…. Une fâcheuse habitude que Rivers Cuomo entretient en fait depuis Ratitude et Hurley. L’affaire est gênante, surtout qu’au fond les meilleurs morceaux du disque sont ceux où Rivers Cuomo se débrouille très bien tout seul – « The British are Coming », « Ain’t got Nobody », « Cleopatra ». On passera l’éponge pour « Go Away », duo correcte chanté et cosigné avec Bethany Cosentino de Best Coast. La question qu’on se pause dorénavant est : Faut-il en passer là pour écouter un bon nouvel album de Weezer ? Si la réponse est oui, mieux vaut alors la prochaine fois ne pas jeter un Å“il sur le livret, au risque de friser la crise cardiaque.
En même temps, à titre d’exemple, personne ne semble s’offusquer que Leonard Cohen délègue sa musique sur son nouvel album à un tâcheron, Patrick Leonard en l’occurrence, qui a fait la richesse de Madonna dans les années 80… Considéré sous cet angle, on peut peut-être faire preuve de tolérance à l’égard du Buddy Holly de l’indie rock.