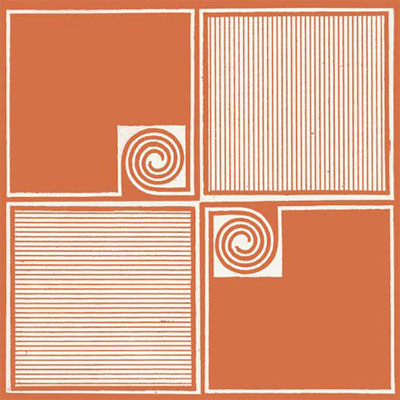Sans fioriture, les Allah Las s’affirment avec « Worship The Sun » comme les leaders de la scène Rock Vintage. Ni plus, ni moins.
C’était il y a presque deux ans : nous vous présentions ces jeunes babas adeptes des ballades Surf Rock garantie 100% Endless Summer, aux vidéos plus vintage que nature (celle des plages Californiennes bien sûr), dont la qualité nous promettait des lendemains qui chantent, des fleurs dans les cheveux, des Free hugs à foison, la paix dans le monde, et plein de poutous tout partout. Bref, dans la palanqué de jeunes pousses qui inondent Youtube de chemises à fleurs depuis quelques temps, les Allah Las se montraient sans doute comme les plus crédibles, et assurément comme les plus décomplexés, et on ne se lasse toujours pas des airs de « Long Journey », « Busman’s Holidays », ou « Catamaran ». Succès critique immédiat, ce premier album éponyme ne connût qu’un engouement relatif auprès du public, la faute à une adaptation peu probante sur scène, peut-être. La même difficulté semble freiner leurs jumeaux maléfiques, The Growlers, dont le nouvel album vient de paraître.
Worship The Sun est un album de saison, celle de l’été indien, période confuse entre joie et nostalgie. Cela débute par un clin d’Å“il bienvenu aux arpèges cultes de « Alone Again Or » de Love, groupe psyché-mythique de la fin des 70’s et influence manifeste de la vague flower-power de l’époque, donnant la couleur de l’album : si le ton reste le même, les titres sonnent plus denses, travaillés, et les Allah Las se diversifient quelques peu : « Better Than Mine » a des accents country, « Nothing to Hide » se recentre sur la voix, tandis que « No Werewolf », l’un des trois instrumental de l’album, et reprise du groupe The Frantics, assombris l’espace sonore, nous plongeant dans une B.O de série Z millésimée 60’s…
Cette évolution musicale se ressent également dans une autre de leur spécialité, les vidéos : Si l’entraînante « I Had it all », dévoilé l’année dernière, nous ramène à leur précédente livraison, avec des images qui collent à l’insouciance de leur musique (nous suivons pêle-mêle les jeunes membres du groupe s’amuser dans une rivière, en bord de mer, ou en plein désert Californien, le soleil couchant, et au travers d’un filtre Instagram « polaroïd »), la dernière susnommée « No Werewolf » propose sobrement une performance hypnotique d’un sculpteur en action, tandis que « 501-415 » se la joue Benny Hill façon pavillon américain. Mais c’est surtout la jolie ballade-titre de l’album, « Buffalo Nickel » qui étonne avec ses images enfantines cubiques, proche de l’univers des Beatles, et qui, associées à cette musique planante, rend l’entreprise de nos quatre Californiens évidente : nous ramener vers cette époque rêvée qui allait impacter tout ce que nous écoutons aujourd’hui. Avec le talent nécessaire pour rattraper ce demi siècle de retard, c’est sans complexe qu’ils participent à cette fête. Et nous dansons avec eux.