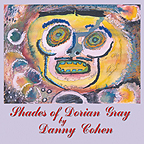Troisième épisode de la résurrection de Danny Cohen, grand songwriter habité et abîmé qui chante l’Amérique en lui tendant un miroir brisé.
Dans le monde de la musique, comme ailleurs, ne pas avoir la gueule de l’emploi prédispose peu à la reconnaissance, fût-elle illusoire ou éphémère. Trop vieux, trop has been, trop dandy fané, trop alcoolisé, trop imprévisible, trop cassé, trop Danny et pas assez Cohen, l’auteur de Shades Of Dorian Gray traîne ses guêtres dans les salles enfumées depuis plus de quarante ans, mais n’a pas vraiment eu l’occasion d’admirer ses facéties à la Une des magazines musicaux qui ont pignon sur rue. Et quand bien même il se déciderait à raser sa moustache d’acteur hollywoodien des années 50, il n’en serait pas davantage récupérable. Cet ancien punk (il a officié à ses débuts, en 1961, dans le groupe Charleston Grotto, alors qu’il n’avait pas douze ans) a gardé un impénitent tempérament de provocateur, allié à une démence intérieure toujours susceptible de le faire sombrer de l’autre côté du raisonnable. D’où, d’ailleurs, un parcours artistique en dents de scie, avec moins de pics vivifiants que de gouffres insondables, marqué par de redoutables phases de retrait de la vie sociale, abandonné qu’il était à la tyrannie de ses chimères. Dans ce contexte dépressif, tout le mérite revient à John Zorn de lui avoir remis le pied à l’étrier à la fin des années 90, en sortant notamment sur son label Tzadik trois disques qui reflétaient ses travaux accumulés sur les trois dernières décennies. Des morceaux à l’image de son créateur : schizophrènes, hallucinés, exubérants, suicidaires, dégénérescents, impubères, géniaux. Suivirent dans la foulée deux albums remarquables, produits dans de plus salutaires conditions mais passés malgré tout relativement inaperçus : Dannyland et We’re All Gunna Die (sortis respectivement en 2004 et 2005). Deux autoportraits poignants et sombres que Shades Of Dorian Gray, nouvelle facette pour le moins aboutie dans son genre, complète aujourd’hui admirablement.
D’aucuns diront de la nature de ce Cohen qu’elle est « rock’n’roll », mais précisons alors tout de suite que Danny laisse aux singes frileux le soin de faire la grimace. Si sa musique évoque bien sûr celle d’originaux barrés comme Daniel Johnston, Tom Waits ou David Thomas, elle n’en demeure pas moins pleinement singulière, impossible à indexer sur le cours de sommités déjà érigées en références. « Rock’n’roll », aussi, en raison de cette faculté insolente à rester jeune d’esprit, voire enfantin. Tel le personnage d’Oscar Wilde dans Le Portrait de Dorian Gray, Danny Cohen semble conserver au fil des années une éternelle jeunesse. Jusqu’au vertige. Nonobstant son âge avancé, le songwriter désinhibé semble constamment mettre son sur-moi en veilleuse et ne rechigne pas à quelques dérapages sonores puérils et autres enfantillages libérateurs (des bruits suspects, des rôts semble-t-il, sont égrenés sur “Noah Baine”), pour ensuite, le titre d’après, se glisser avec gravité dans la peau d’un vieillard à la voix d’outre-tombe (“Rigormortis (On the Ridge)”, “Beneath the Shroud”). Freud a écrit dans On ne peut pas tuer un enfant, que l’homme ne pouvant rester toute sa vie un enfant, il lui fallait s’aventurer dans « l’univers hostile ». Les albums de Danny Cohen laissent précisément entendre cette confrontation à la fois violente et enjouée entre une enfance dévoyée et l’enfer d’être un homme, que Freud appelle aussi « l’éducation à mort ». Un conflit qui, de visions apocalyptiques en rêveries féeriques, de délires macabres en érotisme pervers, de prières délirantes en allégories confessionnelles, secrète les grandes lignes d’un tableau à ne pas mettre entre toutes les mains tant il tient éveillée sa capacité d’effroi chez celui qui lui fait face.
Et la musique dans tout ça ? Elle n’est pas en reste ou, plutôt, elle compose avec les restes. Sur Shades Of Dorian Gray, comme sur ses précédents albums, Danny Cohen fait les poubelles de l’Amérique et lui tend à la figure ses déchets qu’il transforme en or. Se libèrent de la trivialité de notre culture des forces poétiques inavouables, des fantômes à la beauté troublante, une innocence vêtue de guenilles qui refoule subitement à la surface ce que l’on aurait aimé ne jamais voir remonter. Pas moins de douze musiciens ont participé à l’élaboration de Shades Of Dorian Gray, mettant ainsi à profit une riche palette instrumentale (Mellotron, claviers vintage, accordéon, lap steel, organ, violon, trombone, piano à pouces, harmonica, saxophone) que Danny Cohen détourne plus ou moins, revêt d’une inquiétante étrangeté ou éclaire d’un feu ludique. Toutes ses chansons violentent les règles communément admises, dialoguent avec l’ambiguïté des significations, poétisent le convenu afin de substituer à la réalité une autre, en l’occurrence la sienne, plus labile et grotesque, qui en interroge les fondements, comme les apories, et fait saillir l’ennui secrété par la norme. Et réenchantent par la même occasion tout un monde que l’on croyait perdu, enfoui dans la vase du consensus. Folk archaïque, airs de bastringue, pop-songs faméliques, country spectrale et jazz à l’agonie trébuchant sur une patte alternent sur Shades Of Dorian Gray, album bricolé, mais pensé de A à Z, sur lequel des genres musicaux tombés en désuétude ou vaguement ringards retrouvent, même boitillants, une fière prestance. Illuminé, Danny Cohen n’en demeure pas moins un compositeur pointilleux et visionnaire, qui use d’une variété d’arrangements sans cesse renouvelée (il n’y pas deux morceaux sur l’album, qui en compte seize, répondant au même schéma instrumental). A travers cette voix qui déraille, cette musique qui « valse avec la mort » (“Death Waltz” est le titre du quatorzième morceau), raisonne l’expression brute, pleine de bruit et de fureur, d’un monde, le nôtre cette fois-ci, qui s’aveugle à ne plus vouloir se regarder dans le miroir.
– Le site de Anti-.