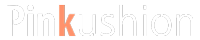Aucun de ces quatres londoniens ne sort avec Gwyneth Paltrow, mais leur musique raviera tout de même les adeptes de mélodies fines tourmentées et autres passionnés de guitares spacieuses et gracieuses.
Reformation interplanétaire oblige, il est de bon ton actuellement lorsqu’on évoque les Pixies, d’encenser leurs deux premiers albums (respectivement Surfer Rosa et Doolittle) et de bien dénigrer le reste. Permettez-moi chers amis de m’insurger devant de si injustes propos.
– Premièrement, il n’y a fondamentalement aucun album faiblard des Pixies, les quatre testaments sont tout bonnement indispensables.
– Secondo, et c’est là que le bas blesse – ma préférence va pour Bossa Nova et Trompe le Monde.
Oui, je vois déjà des airs de dégoût honteux se profiler rien qu’à la lecture de cette phrase maudite : « n’importe quoi, y avais la flamme jusqu’à Doolittle, après ça part en vrille ».
Permettez-moi de dire que celui qui pense cela ça n’a rien compris aux Pixies. Voilà un groupe qui a pondu quatre albums monumentaux dans une période de temps assez inhabituelle (4 ans !), se remettant perpétuellement en question et repoussant chaque fois le potentiel instrumental de son carcan rock (guitare, basse, batterie).
Prenez Bossa Nova. Comment ne pas tomber à genoux devant « Surftones », l’ouverture rock la plus grandiose et génialissime de tous les temps (Placebo, s’en est d’ailleurs souvenu sur son dernier album). Et puis s’en suit un festival de mélodies implacables : le contre-pied renversant de « The happening », la fulgurance mélodique de « Velouria », les deux hymnes imparables que sont « Is She Weird », « Dig For Fire », la rugosité de « Rock Music », la mélancolie Surf d' »Havalina » et j’en oublie… Il n’y a rien à jeter.
Quant à Trompe le Monde, beaucoup lui ont reproché d’avoir un son trop dur, limite métal à sa sortie. Le disque posthume traine depuis une réputation de vilain petit canard. Ceux-là sont passés à côté de l’essentiel : voilà peut-être un des albums de rock les plus sophistiqués jamais enfantés. Il faut se remettre dans le contexte actuel de 1991, tout le monde attend le prochain My Bloody Valentine, et Black Francis en est bien conscient. La réputation des Pixies – meilleur groupe de rock du monde – est en jeu. Trompe le monde est donc le fruit d’un travail acharné pour faire la nique à Loveless, le Smile volontairement inachevé des années 90. Et la performance sonique achevée ici est époustouflante : ce disque posthume ressemble à l’univers d’un clown paranoïaque, monté sur des échasses de super production shoegazer, voué irrémédiablement à l’échec. Véritable puzzle où s’entrecroise de multiples figures de styles, TLM s’écoute pratiquement d’une traite et vous marquera au fer rouge, si vous prenez le soin un temps soit peu de l’écouter. Depuis, d’autres ont essayé de suivre leurs traces sur le même chemin balisé (Foo Fighters, Weezer et même Sugar), mais ne sont arrivés qu’à singer leur dynamique de manière scolaire. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j’envie la personne qui va poser pour la première fois sur sa platine ces deux pierres angulaires du rock indépendant.
Et Seafood dans tout ça ? Et bien pas grand chose à voir, si ce n’est tout de même un goût prononcé pour cette sophistication hérité des Pixies et My Bloody Valentine.
Seafood donc. Totalement outsider dans sa catégorie, voilà encore un exemple de groupe qui mériterait une reconnaissance bien plus large. Ces londoniens en sont déjà à leur troisième album.
Des deux premiers, on se souvient de quelques titres accrocheurs et surtout une efficace participation à un tribute aux Pixies, (fabuleuse version de « Levitate me », vous voyez qu’on y revient !) sans non plus bouleverser le paysage rock, mais rendant des copies sincères. Pour résumer, Seafood et le genre de groupe valeureux à qui il faut donner une seconde chance.
Surtout que beaucoup de choses ont changé depuis When do we start fighting en 2001, dernier album en date. Tout d’abord le quatuor londonien a connu un chamboulement majeur dans sa formation avec le départ de son guitariste Charles Mc Leod, frère de l’illustre Duncan – non, je plaisante – et l’arrivé de Kevin Penney en remplaçant. Il s’ensuit un migrage vers Cooking vynil (maison d’adoption de Frank BLack!) et quelques projets qui leur tiennent à coeur comme la création de leur propre studio d’enregistrement. Pour terminer, la bio du groupe nous apprend que David Line, unique compositeur et leader a frôlé de peu la grande faucheuse voilà un an.
Toutes ses péripéties ont certainement contribué à réactiver leur potentiel artistique, voire l’émanciper. As The Cry Flows a été en parti produit respectivement par Ian Mc Cutchon et Mark Von Hoen. Le premier est l’ex batteur de Slowdive, actuel Mojave 3) et avait déjà produit le premier album ds fuits de mer. Le second est un autre proche du groupe de Neil Halstead et ingénieur attitré de Mojave 3. A noter également au rayon invité que l’omniprésent Ed Harcourt joue du piano sur un des titres de l’album.
Sur cette troisième livraison, le groupe de David Line se veut plus aventureux, plus sombre et emprunte des directions moins coutumières des débuts, comme l’usage appuyé de claviers. Le climat se fait plus orageux sans pour autant tomber dans l’ouragan, disons plutôt que cette musique pourrait décrire à merveille la grisaille avant la tempête.
Le premier titre « Dreamt I ruled the sun », se veut spatial, avec une longue intro piano qui promène l’auditeur vers une sorte de rêve éveillé. L’intrusion du guitariste Kevin Penney a certainement contribué à changer pour beaucoup la donne au niveau du son, définitivement plus fin. Outre le sang neuf, ses états de service au sein des rockers de Billy Mahonie, apportent une note (c’est le cas de le dire) plus profonde à l’ensemble. Les ambiances sont ainsi plus éthérés et on sent que le groupe ne se bride plus et développe des climats instrumentaux sombres parfois à la limite de l’ambient, mais toujours dominé par des guitares. Les passages parfois plus nerveux sont également de toute beauté (« Summer falls », « Sleepover ») et ne virent jamais façon « hymne pour stadium ».
Du reste, Seafood ressemble parfois à un Coldplay qui serait moins tenté de faire dans les concessions et le mielleux, sachant au contraire repousser ses barrières et faire exploser ses tourments, comme sur le charme apaisant de « No Sense of home ». On en conclut que nos lads londoniens auraient certainement cartonné au début des années 90, du temps d’House of love et de James, à l’époque où ce rock là se taillait une place de choix dans les charts.
Seafood est le genre de groupe dont on n’attend pas grand chose à première vue, mais qui surprend son p’tit monde grâce a des efforts accrus et parvient à pousser la barre un peu plus haut à chaque nouvelle étape. Un bien beau divertissement pour adeptes de mélodies fines et passionnés de guitares spacieuses et gracieuses.
-Le site de Seafood