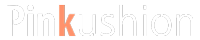Avec cette ambitieuse trilogie musicale, l’éminent guitariste/chanteur de Santa Cruz nous livre en solo sa vision de l’Amérique, quelque part entre Faulkner et Dylan. Une country-folk aussi désenchantée que poétique.
Il faut être un peu inconscient pour se lancer dans une aventure aussi ambitieuse que la réalisation d’un triptyque musical consacré à la culture du grand Ouest américain. Ou, plus simplement, un musicien aux épaules solides mu par une tenace passion que le temps aurait ravivé sans relâche. Bruno Green, un des membres fondateurs du groupe Santa Cruz, mais aussi ingénieur du son et producteur (Miossec, Casse pipe, Thomas Belhom), n’est pas du genre à rouler son monde comme un tapis pour faire de la place à de vaines chimères. Son projet, aussi fou soit-il, a été mûrement réfléchi, s’enracine dans l’expérience prolongée de voyages et de rencontres constructives. Sans doute d’ailleurs que la longue traversée des Etats-Unis qu’il entreprit en 1994 – au cours de laquelle il tourna un documentaire (Cruising the Dream) -, est en grande partie à l’origine de cet imposant The Blue Void Trilogy.
Les musiciens français qui entreprennent de rendre hommage à la culture américaine, à travers plus particulièrement le prisme de l’americana, ne sont pas si nombreux. Alors que les scandinaves ont sans aucun complexe – depuis quelques années et avec plus ou moins de bonheur (cf. la récente compilation Cowboys In Scandinavia) – commencé à défricher le genre, les tentatives françaises se font en effet plus rares. Une discrétion qui rend d’autant plus passionnante la trilogie de Bruno Green, cette oeuvre aussi ample que peu emphatique, enregistrée sur trois années (de 2003 à 2005) et pétrie d’une musique parfaitement maîtrisée qui n’a plus de secret pour le guitariste rennais. Green connaît d’ailleurs suffisamment bien le terrain musical sur lequel il avance pour parvenir à éviter le piège insidieux d’une trop grande admiration qui le verrait suivre timidement un chemin tracé d’avance par quelques émérites songwriters.
Les chansons de The Blue Void Trilogy n’ont rien d’un succédané qui aurait l’apparence de celles de ses modèles avérés (Woodie Guthrie, Neil Young, Bob Dylan), sans en avoir le goût ni la saveur. Musicien mature qui traîne ses guêtres sur les scènes depuis maintenant quatorze ans, Green se pose moins en néo-conservateur du temple Americana, qu’il n’impose avec sobriété et conviction une relecture à la fois fidèle, personnelle et fantasmée du genre. Plutôt que de livrer une somme imposante de chansons hyper-réalistes et prosaïques, il choisit de privilégier une approche plus poétique et littéraire, celle d’un musicien à la fois concerné et observateur d’une réalité quotidienne qui n’est pas la sienne. A cet égard, ses textes suggestifs emblématisent ce rapport légèrement distancié à l’Amérique profonde : les mots construisent un imaginaire tourmenté où les images d’Epinal viennent côtoyer la rudesse de plus sombres visions.
Cela est particulièrement éloquent dans la premier volet, intitulé Horse Mood (2003). L’animalité contrariée, la terre que l’on foule mais qui un jour finit par tout ensevelir, la solitude qui fait l’homme ou le tue, le poids trop dur à porter du monde : sous la plume de Green les mots font mal, ouvre les plaies plus qu’ils ne les pansent. Cette puissance destructrice, héritée de William Faulkner ou Charles Frazier, concilie dans un même mouvement la noirceur et l’élégie. A l’instar de certains de ses contemporains, comme Ben Weaver et Tom Brosseau, Bruno Green évoque avec force et un lyrisme sec une galerie de pauvres gens qui travaillent dur pour survivre. Tous ces perdants anonymes, ces laissés-pour-compte pour qui il milite depuis plusieurs années (au travers par exemple de collectifs d’artistes américains), cette frange de pionniers aujourd’hui oubliés, qui ont oeuvrés, de génération en génération, pour bâtir une nation conquérante qui n’existerait manifestement pas sans eux.
La musique entendue sur Horse Mood s’avère au diapason, épurée et aérienne. L’espace est ample, le son plutôt acoustique et boisé, l’ambiance crépusculaire. Ceux qui suivent Santa Cruz assidûment depuis leurs débuts ne seront pas surpris de retrouver aux côtés de Green, Jacques Auvergne à la basse, Olivier Mellano à la guitare électrique (qui inquiète magnifiquement “Ferriswheel”) et Yves-André Lefeuvre aux arrangements de cordes, ainsi que dans l’ombre la voix fantomatique de Laetitia Sheriff. Mais plus encore, et sans renier toutefois l’apport essentiel des uns ou des autres, on accordera à la présence de Thomas Belhom une importance capitale. Sa batterie communique une densité essentielle aux morceaux de Green : son toucher fin et délicat, tout en nuances, ses trouvailles sans cesse renouvelées de sonorités souvent étonnantes, sa façon de placer ses discrètes interventions au moment vraiment opportun et son incroyable capacité à varier les timbres ; tout cela contribue à rendre les morceaux plus opaques et retors, leur évite de se figer dans une forme conventionnelle sans aspérités.
Sur le deuxième volet, intitulé God’s Country (enregistré au Coccon studio, à Rennes, en février 2005), Thomas Belhom laisse pourtant sa place à Billy Conway (le batteur du défunt groupe Morphine), dont la présence participe, là encore, pour beaucoup au changement de son du disque. Incisive et tranchante, la batterie de Conway associée à la basse de Pascal Humbert (membre de Sixteen Horsepower) créent toutes deux un climat plus spontané et direct. La menace qui couvait dans Horse Mood se fait palpable, la violence moins contenue transpire à travers des choix instrumentaux plus affirmés. Les guitares, notamment, se multiplient : celles de Goulven Hamel, Vassili Caillosse, Pascal Humbert, Red et Jérôme Escoffier viennent prêter mains fortes à Bruno Green pour composer un tableau extatique qui célèbre un souffle vital salutaire, ultime remède à l’accablement et la mort – deux thèmes qui agissent comme une lame de fond dans les textes de Green.
Si d’ailleurs les thèmes de Green restent identiques à ceux de l’album précédent, on note tout de même que la religion, source de délivrance mais aussi miroir aux alouettes qui met l’homme face à sa solitude, occupe dans God’s Country une plus large place. L’écriture parvient en outre à extraire de la noirceur environnante de radieuses envolées stylistiques. Certains textes admirables (“Clouds Never lie”, “All Will Be Known”), qu’incarne avec conviction la voix de Bruno Green, puisent leur essence poétique dans un panthéisme, voire une mythologisation de la nature qui transcendent de belle manière le pessimisme tapi dans le relief des mots. Une qualité d’écriture qui permet aussi d’oublier, avec plus d’indulgence que de coutûme, quelques scories ennuyeuses (l’utilisation des choeurs, des soli de guitare téléphonés ou des ponts sans grande saveur) et des arrangements moins inventifs que précédemment.
The Blue Void Trilogy se clôt avec Father & son, troisième album qui voit le jour au printemps 2005, à Cambridge, dans le Massachussets. Ce retour sur la terre natale de la musique qui a inspiré à Green sa trilogie, accompagné qui plus est de musiciens folk américains issus du collectif Table Top People (Jennifer Kimball, Sean Staples ou Jimmy Ryan), s’avère être le volet le plus classique du lot. Le contenu et la puissance des textes restant irréprochables, c’est musicalement que Father & Son marque une évolution notable. Alors qu’avec God’s Country Green semblait encore (se) chercher une possible alternative musicale, quelque part entre la voie suivit par Santa Cruz et la liberté promise d’un folk plus terrien, Father & Son entérine cette seconde orientation, avec panache et rigueur.
L’album ne commence pourtant pas sous de favorables auspices (toujours l’utilisation de ces coeurs très rébarbatifs qui font pâle figure comparés à ceux récemment entendus chez Sufjan Stevens), mais Green relève vite la barre, dès le second titre “Blue Is My Mind” (ironie du sort, en partie grâce à un emploi plus original des choeurs), et signe ensuite quelques indémodables perles taillées dans un songwriting charpenté. La superbe reprise de “Riding To My Death”, morceau qui ouvrait déjà le premier volume, en dit d’ailleurs long sur l’évolution artistique de Bruno Green : plus immédiate, sa musique aspire à la pureté d’une ligne droite que rien ne viendrait perturber. Moins habitée du dedans (exit la rumination instrumentale qui occupait l’arrière plan de Horse Mood), elle expose à présent avec assurance son fragile équilibre, entre soumission et résistance aux lois de l’americana, telles qu’érigées par ses figures tutélaires (la reprise du morceau “Nebraska” de Bruce Springsteen n’est en ce sens pas innocente).
S’il nous fallait trouver une comparaison cinématographique éloquente, on dirait que Father & son est un album fordien ouvragé, là où Horse Mood était plus baroque et peckinpahien. Moins stylé mais plus authentique, ce troisième opus balaye la poussière déposée sur un genre archaïque, sans toutefois s’en écarter fondamentalement. Entre respect et actualisation du genre, Bruno Green semble avoir trouvé avec Father & son sa voie : celle d’un songwriting humble et généreux, qui bute sur les limites d’une humanité défaillante pour mieux en célébrer l’ultime grandeur.
– Le site de Bruno Green.
– A écouter : “Riding To My Death”.