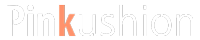Dans la lignée de son précédent opus, l’ex guitariste de Slint continue de perfectionner son folk lunaire, de plus en plus émouvant. Une étoile est née.
Il y a tout juste 15 ans, David Pajo et quelques décérébrés ont poussé le rock dans un coma cérébral sans retour, sur le désormais culte Spiderland. A l’instar du Velvet Underground, le math rock de Slint n’a pratiquement rien vendu en son temps, mais son influence sur la scène post-rock ou plus récemment chez des formations électrons libres contemporaines est incontestable. Depuis, David Pajo est devenu un guitariste très sollicité dans le milieu du rock alternatif, prisé pour son ambivalence ainsi qu’une approche rêche et sans concession de l’instrument. L’essentiel de sa discographie est ponctué de side projects et moults collaborations qui brillent comme de glorieuses décorations sur la chemise d’un soldat : Tortoise, Stereolab, Will Oldham… la liste est prestigieuse.
Et puis en 2002, il s’acoquine à la surprise générale avec Billy Corgan, rock star à la grosse tête (de citrouille) pour former l’archétype du super groupe sans épaisseur, Zwan. Le bruit qui sort des amplis est sans âme et le disque, un four commercial… Depuis cet échec cuisant, la carrière solo de Pajo a pris un tournant plus pop. Comme si Corgan, chaque soir avant de monter sur scène avec Zwan, l’aurait harcelé pour écrire de vraies chansons ou l’inverse, dégoûté d’avoir à jouer des mélodies si insipides. Un effet « soupape de sécurité » a été déclenché : le trop plein de jolies choses enfouies si longtemps dans son subconscient a littéralement explosé à la surface. Heureusement ce jour là, un magnéto 4 pistes était dans les parages. Certes, son autre groupe Papa M livrait déjà quelques brillantes mélodies folk avant l’épisode Zwan, mais rien de comparable avec ce qui se manigance sur son disque éponyme et 1968.
Second album signé sous son Pajo, 1968 est à double titre symbolique : c’est d’abord son année de naissance, mais c’est surtout une période charnière de la pop. La fin des sixties est aujourd’hui considérée comme l’âge d’or de la pop, et 1968 l’épicentre chronologique du mouvement. De l’avis des experts, nos quarante dernières années ne seraient depuis que des cycles s’évertuant à recréer une matière existante. Pour David Pajo, le choix de ce titre porte la nostalgie d’un temps fantasmé et révolu.
Après le noir profond de Pajo, la pochette vire maintenant au blanc. A bien des égards, on pourrait considérer ces deux recueils successifs comme des frères jumeaux par la forme. Mais sur le fond, le songwriting s’est encore affiné. « Chansons d’insomnies », « Yeux cyclone » ou des « Marche à travers l’obscurité » sont des titres on ne peut plus suggestifs sur le caractère solitaire de l’album. Malgré tout, on commence à percevoir dans les chansons de Pajo une lueur, une main tendue au bout du chemin. Sur “We Get Along, Mostly” plus nerveux que d’accoutumée, Pajo laisse même filer de sa voix des “tadadada…” et “Foolish King” surprend par ses arpèges scintillants et émouvants. Régulièrement, on jurerait entendre des chutes studios du Either/Or de feu Elliott Smith, tellement le travail sur cette caisse en bois est digne d’un grand charpentier. Cette voix docile y est également pour beaucoup. “Let it Be Me” et son harmonica de Loner offre une petite incartade Americana. En définitive, 1968 est un disque de guitares, l’instrument du vagabond par excellence. On n’entend que ça dans ce disque, et c’est souvent très beau. Pajo redonne ses lettres de noblesse à l’instrument, pince ses arpèges et glisse sur les frettes avec une passion immodérée.
Ceux qui pensent que les musiciens avant-gardistes sont incapables d’écrire une jolie mélodie sont invités à écouter ce petit chef-d’oeuvre à la beauté lunaire. Sinon, on devrait réentendre la face cérébrale de l’imprévisible Pajo sur le nouveau Tortoise, en octobre.
– Lire également la chronique de Pajo (2005)
– Le site de David Pajo