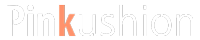Alors que la subite – et pas si novatrice, ni audacieuse – émancipation discographique de Radiohead a récemment fait couler beaucoup d’encre, la sortie fin août du cinquième album autoproduit de Mendelson n’a nullement défrayé la chronique. Avec un titre on ne peut plus explicite, Personne Ne Le Fera Pour Nous, la formation emmenée par Pascal Bouaziz opérait pourtant aussi sa révolution à elle, fière et intransigeante, mais plus subie que voulue : sortir un copieux double-album via son site, c’est-à-dire sans recourir aux circuits de production/distribution en vigueur. La bienséance voudrait bien sûr que l’on s’indigne des lignes entières de pareil abandon de la part d’instances plus mercantiles qu’artistiques, mais laissons aux pleureuses de circonstance le soin de refaire le monde à notre place. Regrettons juste ici en préambule que Mendelson (plus de dix ans d’activité et quatre formidables albums derrière lui) ne jouisse pas dans le milieu vicié du disque (la critique semble, heureusement, pour grande partie déjà acquise à sa cause) d’une reconnaissance à la hauteur de son importance, ne profite d’une considération qui puisse suffire à elle seule à lui garantir une viabilité et une visibilité sur le long terme.
Dans un monde meilleur, Mendelson aurait-il pignon sur rue, des badauds plein son magasin, une cohorte de zélateurs au portillon ? Probablement que non, car s’il est un détail qui n’échappera justement à personne, c’est bien l’aspect farouche de ce rock, sa nature radicale. Frontale, rentre-dedans, cette musique déjoue constamment les attentes, résiste aux tièdes pensées, ne s’arrange d’aucun compromis, ne vise pas l’assentiment général. Musique du refus (de chanter comme il faut, de respecter les structures et formats usuels de la chanson, de s’accorder à nos désirs, de plaire à la ménagère de 50 ans, de feindre la tendresse, de nous laver de nos pêchers), elle jette l’anathème sur une société gavée d’elle-même, écoeurante à force de ne plus vouloir être, mais seulement paraître. Et Pascal Bouaziz de rajouter, autant moqueur que rageur, « J’aime pas les journalistes j’aime pas ceux qui les lisent j’aime pas l’actualité (…) j’aime pas les artistes j’aime pas les gens du spectacle (…) j’aime pas la nouvelle chanson française j’aime pas la nouveauté j’aime pas les bandes d’amis », sur le cinglant et génialement ambigu (où s’arrêtent le pensé et l’impensable ?) “J’aime pas les gens”. Une longue décharge de mots électriques répartis entre deux pôles j’aime/j’aime pas, révélant de fait, presque par l’absurde, la dualité d’un monde binaire cantonné dans son quant à soi, ses idées courtes, sa haine de tout, son manque d’amour.
L’absence d’amour, voilà le grand sujet de Personne Ne Le Fera Pour Nous, portrait acéré de notre époque à la dérive, qui se termine sur l’éloquent morceau “Le Monde disparaît” en ces termes : « Je suis un être humain normal je veux être aimé je veux juste être aimé ». Dans la bouche sucrée de certains chanteurs bien de chez nous ces quelques mots prêteraient à sourire, aspiration caricaturale et naïve à une reconnaissance amoureuse salvatrice ; mais dans celle à la fois calme et révoltée de Pascal Bouaziz, ils parviennent à nous bouleverser au plus haut point car, tels ceux d’un épilogue, ils révèlent in fine le sens profond d’une agonie en rien complaisante et attestent, s’il le fallait, de la cohérence d’un ensemble complexe et touffu. Personne Ne Le Fera Pour Nous, succession d’histoires crues à la fin tragique écrite d’avance, bribes d’existence qui enjambent un bonheur toujours fuyant et finissent par se casser la gueule à force de tituber, roman chanté à la première personne sans compassion, écriture hurlée à la face d’une société cloîtrée chez elle, grand livre ouvert parcouru d’un long frisson de vie et de fatalité. « L’Amour existe » crie son auteur en filigrane de tous ses textes, comme autrefois Maurice Pialat dans son premier court métrage, façon de se persuader que c’est encore possible, que l’avenir est devant, alors que, déjà, il a « la nostalgie de [sa] vie future comme si elle n’allait jamais arriver comme si elle était déjà perdue ». Pialat, immense cinéaste auquel on pense en écoutant Mendelson. Même violence dans la description d’une France presque monstrueuse, même orgueil du solitaire revenu de tout, mais qui, toujours, nous tirera vers le haut, même désinvolture dans l’agencement de blocs de temps, même vivacité et précision dans l’écriture, même élan incontrôlé vers l’abîme, mêmes claques données et reçues, même rapport au réel.
Le réel, la belle affaire. Au naturalisme poétique des petits escrocs qui le bradent sur l’autel d’une sincérité bien propre sur elle, et somme toute alléchante, Mendelson sculpte ses chansons fissurées dans un réel à l’état sauvage, sale et dégueulasse. Pas vraiment documentaire, assurément documenté. Pas ripoliné pour faire vraisemblable, mais simplement « vrai ». Pas le réel qui va de soi, le réel en soi. Un réel qui parle, prend sens à mesure qu’il se dessine. Sous la plume de Pascal Bouaziz, le fait-divers le plus sordide est ainsi élevé au rang de tragédie antique (“Le Sens commun”), les souvenirs se transforment en épopée biographique flamboyante (“1983 (Barbara)”, chef-d’oeuvre absolu de onze minutes, magnifique déclaration d’amour a posteriori, destin qui se réinvente dans un flux de détails étourdissants, puissance narrative explosive du verbe, mise en son admirable au diapason de l’émotion dégagée par les mots) et la banalité d’une vie de couple périmée prend des allures de fatum atavique (“La Honte”). Rocailleux, le chemin emprunté par le réel mendelsonien mène quelque part, se donne pour horizon un but précis : regarder sans sourcilier ce monde qui nous regarde. A la vanité sociale d’exister, aux rôles que l’on enfile comme des gants trop grands pour nous, Mendelson oppose une existence qui ne peut faire l’impasse sur le regard (« Nous sommes ce que nous voyons nous voyons ce que nous voulons voir » dit-il dans “Le Sens commun”). Un regard qui scrute le réel à la manière d’un scanner (titre du morceau qui ouvre l’album), le découpe en tranches afin de mettre en avant les symptômes du cancer qui le ronge de l’intérieur.
Il serait tentant, pour qui ne goûte pas à l’univers brut de décoffrage du groupe, de l’expédier d’un revers de la main sous prétexte de morbidité gratuite ou de désabusement factice. Réflexe courant de ceux qui n’inspectent dans le miroir que leur belle mine, déni du monde dont on rêve de s’absenter, repli de soi sur soi, pour n’y voir que du feu. Pourtant, à la lisière de la noirceur, brûle chez Mendelson un ardent désir de s’en sortir (le lumineux et quasi tubesque “Personne ne le fera pour nous # 2”). Tremper ses mains dans la merde et les montrer à qui veut bien les voir, certes, mais si cela s’avère libérateur. Mendelson ne fait pas dans le reportage voyeuriste ou le social politisé. Ni revendications démagogiques, leçons de bonne conduite, contestations sommaires et moralisme des insurgés. Pas de footing parmi les vraies gens. Et, pourtant, aucun disque récent n’a su ainsi nous restituer l’obscénité bien réelle d’une époque contrainte, à ce point nostalgique, rivée à sa consommation et son individualisme tous azimuts. Mendelson appartient à cette génération – dont nous sommes – née au début des années 70 qui, à défaut de savoir encore conjuguer son avenir à un futur « mal passé, un futur imparfait » (dixit Bouaziz), voire au présent, aspire à revenir en arrière afin de se lover dans les bras d’un temps doré (Dans tes rêves), quand bien même il ne serait qu’un leurre de plus (« Sans moi », superbe chanson sur une rupture amoureuse qui ne dit pas son nom tout de suite). Nostalgie d’un passé plein de promesses non tenues, mais qui avait au moins le mérite de ne pas bafouer la seule possibilité d’en avoir. Lorsqu’on arrive plus à accoucher de rêves, mieux vaut se coucher alors dans ceux que l’on a déjà faits, « un vieux souvenir de lumière un jour de vacances une maison des volets un chemin une rivière ». Constat lucide et glacial, mais certainement pas définitif.
Il serait proprement inadmissible d’achever ici ces quelques lignes enthousiastes sans aborder le travail exceptionnel de l’ensemble du groupe. De ce point de vue, Personne Ne Le Fera Pour Nous accomplit d’ailleurs un pas décisif dans le trajet de Mendelson. Au plus près de la langue de Pascal Bouaziz, les musiciens accompagnent chaque mot comme ils le feraient des images d’un film muet, donnant à entendre toujours plus que ce qui est dit. Effets de contrastes plus que soulignage servile. La musique de Mendelson ne ronronne pas, elle chahute les oreilles, du côté de l’action, elle provoque, déstabilise, renchérit ou laisse aller. Guitares électriques phobiques (Pierre-Yves Louis et Bouaziz), batterie clandestine (Sylvain Joasson), basse sournoise (Pierre-Yves Louis), piano et Fender Rhodes pleins d’aplomb (Charlie O), saxophone furieux (Quentin Rollet), flûte charmeuse (Francine « Siné ») et Mellotron hanté (Nicolas Becker) décrivent autour des mots un périmètre sonore tout en reliefs et nuances, à rebours d’un rock de petits bras et idées fixes qui dévale la pente de l’anecdotique. Personne Ne Le Fera Pour Nous atteste d’une éclatante variété de tons, de matières et de climats (de la rage autodestructrice de “Crétin” à la douceur reposante de “Sans moi”, le spectre de couleurs a rarement été aussi étendu chez le groupe), que la prise en son direct intensifie. Des seize morceaux de l’album, enregistrés le plus souvent en une ou deux prises, transpire une liberté arrachée à la glu du vérisme. Pas une spontanéité synonyme de n’importe-quoi-pourvu-que-ça-ait-l’air-authentique, plutôt une autonomie réfléchie. Retour du réel sous son versant sonore et musical, immersion au coeur du processus créatif, jeu sans filet nous soulageant de toutes ces subversions conformistes qui inondent habituellement nos tympans. Applaudissons des deux mains et gageons qu’un tel bienfait stimule les sourdes oreilles qui ne semblent entendre que le bruit des sous dans leur porte-monnaie.
– Le site de Mendelson.
– La page Myspace de Mendelson.