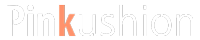Pour leur huitième album, Distorsion, les champs magnétiques cheminent entre des polarités variables.
Entre voyages et transports amoureux, tourments du moi et lyrisme épique, entre mélodie et réverbération, érudition et dénuement, sophistication et sobriété, une tension hante la musique de Magnetic Fields, qui ne cesse, depuis déjà dix-sept ans et huit albums, de multiplier les variations et les polarités, les genres et les rythmes, dérivant, insaisissable et inattendue. Épigone d’un nomadisme thématique et musical, Stephen Merrit incarne à la fois le ferment et l’identité de ces champs magnétiques variables, comblant et imprégnant de sa voix traînante et archaïque toutes les métamorphoses, jouant cantabile comme portée par l’intensité d’instrumentation polymorphe.
Éreinté par les affres d’une identité transie par le mensonge et la finitude, Magnetic Fields nous avait laissés seuls et étourdis depuis l’album I en 2004 aux compositions minimalistes, déclinant de tristes et renversantes ritournelles.
Justement intitulé Distorsion, ce nouvel album pousse à son paroxysme l’éclatement des tonalités en travestissant et dissimulant la voix de Stephen Merrit, allant même jusqu’à la remplacer d’un morceau à l’autre par celle, plus haute, de Shirley Simms. Rien d’isotrope dès lors dans ce disque mais, au contraire, d’inépuisables réfractions sonores comme arrière-fond, comme confusion originelle, des filtres, des trompe-oreilles comme on parle de trompe-l’oeil, des empressements soudains, des accumulations phoniques, comme autant de supports instables de la mélodie.
Mais originelle n’est pas originale, et à trop vouloir arpenter des paysages mélodiques variés, à emprunter des chemins de traverse il n’est pas sûr que Magnetic Fields ne fasse pas du surplace. À se contorsionner, la musique, ici, paraît bien rigide.
D’emblée on ressent à l’écoute de Distorsion, la double influence de Jesus and Mary Chain et de My Bloody Valentine. Omniprésence de la propagation du son jamais interrompue, réverbération, étirement des notes, entrechoquement des accords : tout se passe comme si les sons étaient lancés puis livrés à eux-mêmes, au hasard de leur improbable rencontre pour faire jaillir la musique, à la contingence de leur combinaison, de leur germination. Ainsi, chaque titre semble promettre d’être à la fois comme en suspension et comme en expansion, car y gît un maelström d’échos, de vibration et de bruits. Mais, contrairement par exemple à Loveless de My Bloody Valentine, Distorsion semble faire volte-face devant l’émancipation du torrent sonique, et plutôt que de laisser poindre les harmonies issues de la saturation, celles-ci apparaissent comme plaquées artificiellement. A l’émergence organique de mélodies sophistiquées Magnetic Fields préfère le fard et le maquillage, le recouvrement et la linéarité. En témoigne “Three-Way” aux arrangements bruitistes et à la sonorité lourde dont tout pourrait surgir et qui se contente paresseusement de s’interrompre afin que des choeurs entonnent, avec une ferveur feinte, le refrain éponyme.
Ce constat passablement décevant se confirme à l’écoute de l’album dans lequel trop souvent à l’assemblage hétéroclite fécond se substitue un nivellement musical dont ne se dégage que le chant occultant les instruments, contrôlant le débordement par la voix (“Xavier says” ; “Driver, Drive On”). L’album tout entier manque alors cruellement de contrastes, de dissonances, malgré les intentions affichées et répétées à outrance par l’alternance des voix et leur constante déformation (“The Nun’s Litany” ; “Zombie Boy”).
Il y a certes bien des exceptions dans lesquelles la distorsion annoncée s’accomplit et où la musique de Magnetic Fields retrouve sa singularité. “Too Drunk To Dream” (référence sage mais indubitable au “Too Drunk To Fuck” des Dead Kennedy’s) est justement ce déséquilibre compensé, presque dionysiaque (rien à voir avec le groupe français) entre l’élégance de la voix et le désordre sonore qui la porte et qu’elle accomplit par contraste. Étonnamment, ce sont les titres tout à la fois les plus épurés et les plus convenus, du moins les moins surprenants, qui confèrent un attrait réel à Distorsion. De l’ironique mais imparable “California Girl” au mélancolique “Old Fools” en passant par “Please Stop Dancing” et “Courtesans”, se dessine une traversée des courants de la pop inspirée de ces quarante dernières années : des Beach boys à Divine Comedy , de Scott Walker à… Magnetic Fields !!!
“I Wish I Had An Evil Twin” proclamait Stephen Merrit dans I. Gageons que son souhait s’est réalisé et que l’on attribuera à ce jumeau machiavélique cette oeuvre atypique et inégale. Album au mouvement forcé, ce n’est que dans les moments trop rares où l’inattendu advient et où le chant accueille les possibles harmoniques que le disque révèle sa beauté et que la singulière intensité de Magnetic Fields s’épanouit. Parfois alors Distorsion trouve sa voie/voix.
– Le site officiel
– Le MySpace