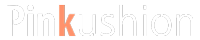Incroyable revirement de situation. On pensait qu’Elvis Perkins avait vidé ses tripes dans un premier album ô combien personnel par la force des choses, on se rend compte qu’il n’avait fait que lever le coin du voile préservant un talent que l’on imagine désormais inépuisable avant longtemps.
Renaître de ses cendres. Laisser ses malheurs en jachère, les abandonner dans un premier disque de toute beauté, un Ash Wednesday déposé sur le paillasson de la maison de la célébrité, déjà vécue par ascendant et délaissée dans un même élan. Et revenir en bande, creuser son sillon, prolonger la quête et suivre ses racines jusqu’aux plus profondes. Exhumer les petites joies et les grands bonheurs des pionniers qui sont un peu de soi, et rendre hommage à leur musique et leur mode de vie en les frottant à l’électricité contenue du XXIème siècle. Aller au-delà de l’histoire, tragique, de sa famille et la fondre dans la grande, celle si dense, si jeune et tellement riche de son peuple. Et en livrer une oeuvre aussi personnelle qu’universelle. Elvis Perkins In Dearland, c’est un peu Alice qui poursuit le lapin, non pas pour fuir ses congénères ou tenter des expériences lysergiques par procuration, mais plutôt pour noyer son incommensurable chagrin dans la somme de tous les états d’âme de tous ceux qui étaient là avant lui. D’un point de vue psychanalytique, il s’agit d’une démarche peu commune. D’un point de vue musical, cela donne tout simplement un disque inespéré, passeport pour un univers que l’on ne connaît finalement que par clichés, formidable feu d’artifices traversé par toute une palette d’émotions allant de la mélancolie de l’aube à l’allégresse de veillée festive, en passant par la légèreté de l’humeur, ployant sous la chaleur d’un midi laborieux en plein cagnard.
On imaginait mal comment Elvis Perkins se sortirait du schéma qui s’était imposé à lui lors de l’enregistrement de son premier album, frappé en plein vol par l’horreur, la mort brutale de sa mère dans un des avions du 11 septembre. Finalement, Ash Wednesday, derrières ses chansons à fleur de peau et son titre plus qu’évocateur, laissait peu de champ à l’immense tristesse ressentie à ce moment là. On aurait compris à moins que ce thème en fût devenu obsessionnel. Dearland, c’est tout l’opposé. On y entend du folk ancestral, des fanfares, des chorales, du blues, et surtout des chansons magnifiques dans leur évidence. Soit à peu près tout ce qui a amené à Woody Guthrie mélangé dans le grand chaudron folk rock sans que cela ne laisse de goût amer dans la bouche.
“Shampoo” lance le bal sur une cadence toute martiale, cortège bigarré conduit par des guitares directives, appuyée par un orgue en larmes et un harmonica compassionnel, le tout porté par la voix du chanteur, vibrante et profonde. L’impression d’avoir affaire à une musique ample et généreuse, malgré la tristesse de ce premier titre, saute à la gorge, et cette luxuriance d’arrangements, d’harmonies et de sentiments n’abandonnera jamais Dearland. “Hey”, avec un groupe tout aussi puissant, se livre au contraire à un jeu de gamineries éthyliques auquel on se laisse volontiers prendre. Pour céder la place à “Hours last Stand”, lente marche funèbre magnifiée par un tapis de cordes écrues.
Ainsi, Perkins, épaulé de ses acolytes, Nick Kinsey, Brigham J. Brough et Wyndham Boylan-Garnett, a-t-il considérablement musclé ses compositions, se livrant à moult explorations, s’autorisant des tunnels temporels auxquels peu d’universitaires survivraient, et devient dès lors le chantre du folk rural tel qu’il devait être joué au fin fond du Minnesota le samedi soir avant que le téléphone n’entre dans les foyers sans jurer à l’heure du tout numérique. C’est la clé de Dearland, Perkins ayant su s’entourer d’un groupe redoutable, solide et insubmersible, pour livrer sa peine, toujours camouflée dans ses textes poignants, longs récits comme autant de légendes que l’on partagerait en veillée. Car cette musique foisonnante, qui prend aux tripes, qui surprend à la première comme à la centième écoute, est le fruit d’une collaboration inscrite dans la complicité la plus aboutie. Les cuivres qui traversent et illuminent l’album, les bruits de chaînes, les guitares qui ne s’essoufflent jamais, tout contribue à porter ces mélodies sans aspérité et ces paroles viscérales à la croisée des vents, pour les éparpiller un peu partout, sans direction apparente. Le blues un peu forcé de “I’ll be Arriving” ou l’énergie monumentale de “Doomsday” collent parfaitement au doux tumulte de “Chains, Chains, Chains” ou l’ivresse déchirante de “Send my Fond Regards to Lonelyville” en un patchwork incessant et épuisant, mais de cette saine fatigue addictive d’après l’effort physique.
Et Elvis Perkins In Dearland de se révéler comme un disque charnel, dont on n’a pas fini de faire le tour, faisant de son auteur un phénomène dont on scrutera le moindre mouvement à l’avenir s’il continue à conjuguer de la sorte l’effet de surprise et l’excellence avec autant de facilité. Tout simplement époustouflant.
– Son MySpace
– Le site officiel