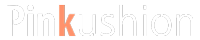Désiré est le nouveau prénom du Loner. Plus de dix ans qu’il promettait de livrer ses archives l’année prochaine. Cette fois elles sont bel et bien là, du moins le premier volet. L’occasion pour nous de revenir sur les trois disques live livrés en pitance pour faire patienter.
Rarement article aura aussi bien porté son nom. Car de disques d’archives, au moment d’attaquer ces lignes, nous n’en disposions que de trois. Mais maintenant qu’il ne suffit plus que de débourser 320$ pour obtenir la version DVD du premier volume des archives (un peu plus pour le Blue-Ray, sans commentaire), cessons de ronger notre frein et revenons sur les trois premiers volets des NYAPS (soit les Neil Young Archives Performance Series), Sugar Mountain, Live At Filmore East et Live At Massey Hall. Comme des os à ronger jetés à la meute de chiens, ces trois témoignages scéniques ont fait bien plus qu’accompagner une patience que l’on a fini par croire vaine, ils nous ont fait encore un peu plus considérer le cas Neil Young.
Au delà de simples documents historiques, cette série de trois disques permet d’observer l’évolution fulgurante du phénomène que deviendra Neil Young : trois concerts en trois dates dans trois villes symboles. Un départ à Ann Harbor, la ville étudiante par excellence, puis la consécration dans le Saint des Saints à New-York et, enfin, le retour au pays auréolé d’une gloire déjà immense, à Toronto. Triptyque indissociable avec, en fil rouge, des titres en commun dont les différentes versions permettent de mesurer cette évolution.
Sugar Mountain, enregistré le 9 novembre 1968

Sugar Mountain est l’étendard de sa déclaration d’indépendance vis à vis de son groupe initial, le Buffalo Springfield, pour le compte duquel il a pourtant livré des pièces majeures — il porte même le numéro de référence 00, tel le véritable coup de feu de départ. Auteur en solo d’un simple album éponyme qui fut un fiasco commercial, le jeune Canadien alors âgé de 23 ans livre ses propres créations à un public clairsemé. Parsemé de « rap », longs passages drolatiques dont il sera coutumier et au cours desquels il rit de sa carrière, décrit ses méthodes d’écriture ou dépeint avec sarcasme la naissance du surnom de « Loner », ce concert est un peu plombé par une captation sèche et brute au son approximatif (on y entend le souffle de la bande), défaut qui n’enlève rien à son pouvoir d’attraction. Pour autant, si l’homme s’amuse de sa situation, le songwriter se révèle déjà exceptionnel. Le tracklisting parle de lui-même : “Birds”, “Out of my Mind”, “Expecting to Fly” ou “Broken Arrow” sont quelques uns de ces futurs classiques livrés dans leur nudité néo-natale. Si le jeu de guitare du jeune musicien est encore ceint d’un académisme touchant a posteriori, le chanteur émeut avec ce filet de voix frêle et impalpable. Subtilité des compositions, finesse des mélodies et force des textes: tout était déjà là, enfoui dans ce grand corps mal foutu et caché derrière cette tignasse rappelant les lointaines origines indiennes (des Indiens d’Amérique) du jeune homme. Tout est dit dans le regard perçant qui mitraille la photo du disque. Neil Young, la légende, naît littéralement entre nos oreilles dans Sugar Mountain. Tout ce qui viendra ensuite ne consistera qu’à un polissage infini de ce diamant brut.
A noter que cette réédition est dotée d’un DVD parfaitement inutile, constitué de la même bande son illustrée par la jaquette du disque, avec en bonus un teaser plutôt marrant des archives.
Live At The Fillmore East, enregistré les 6 et 7 mars 1970

Changement radical de registre, et même de période. S’il ne s’est passé que deux ans entre ce concert et le précédent, tout a changé dans la vie du Loner. Devenu une star en un seul album en 1969, l’électrisant Everybody Knows This Is Nowhere, Neil Young n’est désormais plus seul. Il est accompagné d’un groupe de malfrats, Crazy Horse, comptant dans ses rangs Jack Nitzsche (son fidèle producteur) au piano électrique, Billy Talbot à la basse, le chevelu Ralph Molina à la batterie et surtout un certain Danny Whitten à la guitare et au chant — l’autre pilier du combo qui succombera à une overdose en 1972 après s’être fait renvoyer d’une séance de répétition par Young, disparition dont ce dernier ne se remettra jamais complètement. Au cours de ce concert new-yorkais à l’affiche exceptionnelle (qu’il partage avec un certain Miles Davis), on découvre sur scène un Neil Young agressif, voûté sur sa guitare électrique (il a déjà cette attitude anti-glamour si caractéristique, comme s’il était chaussé d’oursins) qu’il maltraite et dont il tire le maximum. Ce disque a la particularité de ne proposer que la deuxième partie du concert donné ce soir-là (il a assuré seul la première partie, en configuration acoustique) et de fait seulement six titres : “Everybody Knows This Is Nowhere”, “Winterlong”, “Down By The River”, “Wonderin”, “Come On Baby Let’s Go Dowtown” et l’incontournable “Cowgirl In The Sand”, soit ni plus ni moins que six standards dont cinq signés du Loner et le sixième de Danny Whitten — “Come on Baby Let’ Go Downtown”, c’est d’ailleurs cette version que l’on retrouvera en 1975 sur Tonight’s The Night. La captation y est déjà nettement plus « propre » que sur le précédent ouvrage, rendant ainsi parfaitement compte de la sècheresse du son du groupe. Les chansons défilent en long solis abrasifs qui deviendront légendaires, solis inhospitaliers, moitié improvisés, moitié cravachés, démontrant l’immense maîtrise de la six-cordes du bonhomme — la version de “Cowgirl In The Sand” livrée ici est à couper le souffle. Cette fois, il n’est plus seul maître à bord et laisse une large part de la réussite de ce set à ses complices (également ses amis les plus proches), chacun y trouvant sa place, au point que la voix de Young est souvent couverte par celle, plus rauque, de Whitten.
La setlist navigue donc entre les deux premiers albums enregistrés en groupe, soit Everybody Knows… et Tonight’s The Night, deux albums pourtant séparés de six ans et la disparition brutale du fondateur du groupe. Le recul permet de constater une fois encore combien tout est déjà intégralement gravé dans l’ADN du chanteur. Autre information de taille, Neil Young n’est plus un simple folkeux, il est aussi un rocker incandescent et abouti, dont on n’appréciera que bien plus tard l’influence qu’il aura sur plusieurs générations de baby-stars aux cheveux gras. Une fois encore, tout le côté violent du gars est déjà là, en creux ; il ne manque plus que le chanteur bouleversant et le tableau sera complet.
Live At Massey Hall, enregistré en 1971

1971, soit le climax de la période dorée de Neil Young. Il a depuis longtemps émergé, puis largement dépassé ses ex-employeurs, Buffalo Springfield d’abord, et surtout Crosby, Stills & Nash qui auraient bien aimé s’appuyer sur leur benjamin comme sur un simple faire-valoir de talent mis entre parenthèses sur les jaquettes de disques. Pourtant, les preuves sont là, éclatantes. Neil Young écrit des chansons comme Picasso enchaînait les esquisses, avec une facilité déconcertante, à la limite de la fébrilité, pour un rendu toujours abouti. Au-delà, il les manipule, les transforme à sa guise au gré d’interprétations chaque fois uniques. Lorsqu’il arpente la scène du Massey Hall, à Toronto, en 1971, outre le retour au bercail de l’enfant prodige, il se passe quelque chose qui sort du commun car il est armé de ses compositions parmi les plus renversantes. Outre les sempiternnelles “Cowgirl in the Sand” et “Down by the River”, on y découvre les toutes fraîches “See the Sky about to Rain”, “Tell me Why”, “Old Man”, “A Man needs a Maid”, soit rien de moins que la colonne vertébrale de chacun de ces cinq albums parmi les plus précieux déjà publiés ou à venir — dont certains plusieurs années après — : Everybody Knows This Is Nowhere (1969) évidemment, mais aussi After The Goldrush (1970), Harvest (1972), On The Beach (1974) et bien sûr Tonight’s The Night (1975). C’est paradoxalement sur ce live acoustique que perce le plus la bête de scène qu’est Neil Young : puissant, magnétique, sauvage, ou au contraire séraphique, hypnotique même, sa voix tutoie les cimes, virevolte et transperce régulièrement la voûte céleste.
Doté d’une captation parfaite, Live At Massey Hall brille par le dénuement de certains morceaux initialement électriques ou orchestrés. Les versions épurées de “Down By The River” ou “Cowgirl in the Sand” sont des modèles de songwriting — ne dit-on pas qu’une bonne chanson doit tenir toute seule, sans artifice. Ou quand il revient sur de vieux morceaux déjà exposés mais autrement plus puissants sur cette tournée, tel “On the Way Home”, qui ouvre ce disque et Sugar Mountain, excellent point de mesure. Ou encore ceux qui composeront Harvest, l’album que le Canadien a à ce jour le plus vendu — sans être celui qui vieillira le mieux — : “Old Man”, “The Needle and the Damage Done” ou “A Man needs a Maid” — combinée ici à “Heart of Gold” — y sont nettement plus intéressantes que dans leur version studio quand elles croulent sous le déluge de cordes que Nitzsche lui octroiera, dans la pure lignée spectorienne — ce qui, plus tard, lui sera reproché par le Loner lui-même qui, du coup, lui restraindra son champ d’action.
Autre nouveauté, Neil Young s’attaque au piano, et l’on sait depuis combien ses pièces livrées sur ivoire sont parmi les plus déchirantes, avec “Journey Through The Past” en point d’orgue, talonnée par “Love in Mind” ou le medley précité “A Man needs a Maid/Heart of Gold”. On découvre enfin un Neil Young mature, se jouant de toute la palette d’émotions avec une facilité déconcertante, y compris la frivolité sur “Dance Dance Dance”, étonnante quadrille offerte au Crazy Horse pour leur album éponyme paru l’année précédente, et qui tranche avec sa jovialité communicative. Car si ses chansons sont à ce point sidérantes, elles ont toutes pour point commun de ne le devoir finalement à pas grand chose : une mélodie angélique, une voix irréelle, et un texte loin de toute figure stylistique inutile. La seule différence qui transparaît, c’est l’interprétation, le ton adopté ; la phrase « Down by the river / I shot my baby » — “Down by te River” –, n’a absolument pas la même couleur ici que dans le live à Fillmore ou dans l’album dont elle est issue : pétrifiante en version électrique, elle est teintée d’une douleur immense en version acoustique.
Le DVD livré ici est autrement plus consistant que celui de Sugar Mountain. Il s’agit d’un montage d’images enregistrées lors du show donné la veille au même endroit sur la bande-son de ce concert-ci, conférant à l’ensemble un décalage surréaliste qui accentue encore un peu plus l’impression d’atemporalité qui se dégage de ce concert — et de cette oeuvre. En outre, on y voit une interview de Johnny Cash donnée à un parterre d’étudiants au lendemain d’un mouvement contestataire, touchant hommage à l’un des rares maîtres incontestables que se reconnaît Young avec Bob Dylan ou John Lennon.
Finalement, on tient avec ces trois disques les preuves tangibles de la manière dont Neil Young intègrera la caste des très rares artistes à entrer dans l’éternité. Car s’il a depuis souvent atteint de tels sommets, il ne l’a jamais fait en un temps aussi concentré (quatre années auront suffi à poser les jalons d’une oeuvre inouïe, quatre années pourtant sévèrement perturbées par des addictions parfois dangereusement extrêmes pour l’homme) et avec un telle densité. Depuis, si Neil Young s’est autorisé quelques trous d’air vertigineux et s’il a une conscience accrue de la valeur de son travail, il ne s’est jamais contenté de capitaliser sur ce trésor, il pousuit encore et toujours sa quête, modeste devant son art, et humble devant la vie qui lui a asséné les coups parmi les plus durs qu’un homme puisse recevoir. Et ne rechigne jamais à encourager ses héritiers, en passeur qu’il a toujours été.
– Visiter le garage de Neil Young
Dans la série Trois disques sinon rien, lire également :
– Pierre Bastien
– John Zorn
– Mendelson